Critique du film This is the end d’Evan Goldberg et Seth Rogen, 2013
Qu’est-ce qu’une satire ? Allons voir un peu du côté de sa définition et de son étymologie. La satire peut être à la fois comprise comme une production moqueuse, qui s’attaque à quelqu’un ou quelque chose, mais aussi, d’après satura en latin, comme un pot-pourri, un mélange. This is the end réussit à être les deux. Ce film est une satire, ou en d’autres termes, c’est un joyeux bordel qui accumule les parodies pour se moquer de tout et surtout de ceux qui font le film.
Dans le film, la dimension satirique se veut très « méta », selon deux modalités. D’abord, les personnages-célébrités sont complètement tournés au ridicule, ce qui peut faire du film un gigantesque gag à lui tout seul. Cette tonalité connaît une sorte de crescendo, en utilisant d’abord le contexte de la fête, pour rire par exemple de Michael Cera saoul et toxicomane, pour ensuite situer ces célébrités dans un contexte de rupture, avec le tremblement de terre. La rupture montre ainsi un Kevin Hart frappant Aziz Ansari pour essayer d’échapper à la mort ou encore la mort ridicule à souhait et excessivement amorcée de David Krumholtz. Plus le film avance, plus les personnages sont ridicules jusqu’à une certaine limite où un minimum de sérieux s’insère dans le film. La scène où Jonah Hill est possédé en est un bon exemple. James Franco et Seth Rogen galèrent pour s’en sortir et les gags deviennent vecteur d’une sensation de danger, on retrouve ici un procédé classique qui trouve dans l’enjeu dramatique un ressort comique, jouant sur le contraste entre situation et action. C’est justement après ce passage que le film démarre sa dernière partie, cherchant à conclure le fil rouge de l’Apocalypse de la Bible, et rappelant donc le besoin pour nos personnages d’être « bons ».
L’importance du rapport satirique aux personnages et aux célébrités rappelle à quel point la dimension « méta » du film est prédominante. Surtout, la dimension satirique se veut « méta » car elle exploite sans cesse le genre de la parodie, parfois de manière subtile, souvent de manière outrancière. La succession de parodies fait du film un buddy movie classique, agrémenté d’un peu d’horreur, de survie, de suspens, de slasher, de huis-clos, de found footage, de film catastrophe et surtout de fantastique (et je dois en oublier). C’est sans doute cette part de fantastique qui permet au film d’être autre chose qu’un Scary movie, autre chose qu’une pure comédie. Le film commence et se termine comme un buddy-movie mais la fin typique de ce genre de film, avec l’union des deux potes qui se rapprochent après s’être éloignés, se déroule dans un cadre fantastico-religieux qui exacerbe totalement la mise en scène de toute la chose. Dans This is the end, le happy end classique devient une réunion de célébrités qui viennent d’arriver au paradis et dansent en live sur Everybody avec les Backstreet Boys, recopiant la chorégraphie du clip. Mais allons justement voir ce clip. Ce clip est une sorte de parodie d’un film d’horreur. Là où le clip de Thriller semble tout de même assez sérieux et proche du genre horrifique, le clip de Everybody des Backstreet Boys se joue totalement des codes de l’horreur. Le film est à l’image du clip, des personnalités connues se mettent en scène, autant comme personnages que comme célébrités, pour récupérer différentes « modes » cinématographiques.
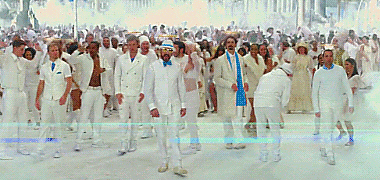
Le film semble fonctionner parce qu’il expose à l’extrême le travail des manipulations des codes qui lui donne forme. C’est ce qui explique l’importance du passage, peu subtil, où James Franco et Seth Rogen initient la réalisation d’une suite à The Pineapple Express, proposant de montrer une parodie de processus créatif et de réalisation. Ce qui semble assez bizarre et particulier, c’est que l’on ne peut pas s’empêcher, en regardant This is the end, de penser à la réalisation du film. Le côté méta, la saturation de scènes comiques qui tournent en dérision le tragique de la fin du monde, un montage parfois très dynamique, certains dialogues qui semblent (volontairement) mal écrit ou improvisés, tout converge pour dire à la personne qui visionne ce film qu’elle est bel et bien devant un film. On a alors l’impression qu’on veut absolument nous montrer un geste, plus un geste de réalisation qu’un geste cinématographique. C’est pour cette raison, je crois, que This is the end est un chef d’œuvre. Non pas un chef d’œuvre en tant que futur grand classique du cinéma mais un chef d’œuvre dans son acceptation artisanale, au sein du compagnonnage. This is the end se veut virtuose, c’est un film qui souhaite exposer son geste et sa pratique du cinéma, à travers la parodie, le tout devant l’autorité abstraite de l’histoire du cinéma et du monde du cinéma actuel. L’enjeu est explicitement évoqué dès le début du film lorsqu’un journaliste demande à Seth Rogen quand est-ce qu’il va se mettre à faire du « real acting », lui qui fait toujours le même rôle dans chaque film. Le film se constitue alors en réponse à cette remarque : Seth Rogen parodie du Seth Rogen qui joue des personnages parodiques (bonjour les tartines de « méta »). Chaque genre semble être reproductible par l’équipe du film selon son goût. Un goût qui peut être un mauvais goût, excessivement grivois, comme lorsque les protagonistes dorment ensemble la première nuit après le tremblement de terre, moment propice à l’émotion et la confession qui se transforme en farce sexuelle. Un goût qui, à l’inverse, peut s’exprimer dans une technicité rigoureuse, la parodie de The Exorcist étant très réussie.
This is the end expose finalement une troisième voie entre la comédie pure, cherchant le gag ou la punchline, et un cinéma qui semble plus sérieux et travaillé, en s’appuyant sur la pratique de la parodie. James Franco, Evan Goldberg, Seth Rogen et toute leur bande montrent avec ce film que ce qu’ils produisent peut être bien plus que grivoiserie, drogue et « fuck » dans chaque phrase. N’est-ce pas d’ailleurs génial de voir ce film comme un chef d’œuvre de compagnon(s), puisqu’il s’agit avant tout d’une œuvre assez représentative d’un groupe, ce même groupe qui poussera quelques années plus tard cette logique de parodie, de copie et d’hommage au cinéma, en nous proposant The Disaster Artist.
Crédits : Sony Pictures Entertainment; Sony Pictures Releasing France
